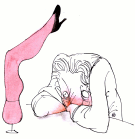|

|
| Actuellement 24 visiteurs sur le site ! |
Focus
Clos Romain, Phidias 2009 
Vinifié en amphore. Très fruité et sucré presque compoté. Une belle réussite. Très agréable à boire de suite. Domaino-buzz
Agenda
Collaboration
|
Bonus - A consommer avec modérationmardi 31 août 2010, par
Abus d’alcoolEn France, pour les personnes âgées de 20 à 79 ans, 1 homme sur 3 et 1 femme sur 10 déclarent consommer de l’alcool chaque jour ; 7 hommes sur 10 et 4 femmes sur 10 disent en faire autant une fois par semaine. Selon l’OMS, une consommation hebdomadaire d’alcool supérieure à 21 verres de vin pour un homme ou 14 verres pour une femme, définit le seuil de consommation excessive. Pour être plus précis, l’apport quotidien ne devrait pas dépasser l’équivalent de 20 g d’alcool pur, c’est-à-dire 2 verres de 10 cl de vin ou 2 verres de 25 cl de bières ou 1 verre de 6 cl d’alcool fort. En résumé, on devient un consommateur excessif quand on atteint ou dépasse la limite des 3 à 4 verres de vin par jour mais, du fait de la sensibilité à l’alcool fortement variable d’une personne à l’autre, il n’est pas possible de quantifier plus précisément le seuil de consommation excessive. On peut toutefois en remarquer les conséquences, sur la santé physique (cirrhose, pancréatite, polynévrite, cancer), sur la santé psychique (dépression, violence) et sur le comportement social (absentéisme, défaut de performances, négligences). De plus, l’incidence de l’alcool pèse lourdement sur la sécurité routière : environ 1/3 des présumés responsables d’un accident mortel seraient en alcoolémie illégale. De même, le nombre d’accidents du travail imputables à l’alcool serait de 120 000 par an. On estime aussi que 60 % des conduites criminelles et 50 % des conduites suicidaires seraient liées plus ou moins directement à la consommation excessive d’alcool. AlcoolismeL’alcoolisme est un mal différent, il ne s’agit pas uniquement de consommation excessive. Pourtant, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) proposait, dès 1951, la formule suivante : « les alcooliques sont des buveurs excessifs dont la dépendance à l’égard de l’alcool est telle qu’ils présentent, soit un trouble mental décelable, soit des manifestations affectant leur santé physique ou mentale, leurs relations avec autrui et leur bon comportement social et économique, soit des prodromes de troubles de ce genre. Ils doivent être soumis à un traitement ». La notion d’excès était privilégiée. Mais l’alcoolisme chronique concerne des sujets absorbant quotidiennement de l’alcool, depuis une période de plusieurs mois ou années.
Le risque majeur pour la santé des consommateurs de vin semble donc lié à l’alcool qu’il contient, avant même de se poser la question des résidus de pesticides et autres substances toxiques. Toutefois, la modération apporte une solution simple et permet de profiter des bienfaits (physiques, psychiques et sociaux) de la consommation de vin. Mais qu’en est-il de l’influence des résidus de produits toxiques ? Les enjeux pour la Santé PubliqueLa consommation d’alcool en France diminue régulièrement depuis plusieurs décennies, en moyenne de 1 % par an depuis la fin des années 60. Et cette baisse est directement liée à la diminution de la consommation de vin. Mais c’est en Europe que la consommation d’alcool par habitant est la plus élevée au monde. La moyenne par adulte et par an dans l’UE se situe à 10,7 litres d’équivalent alcool pur. Le niveau de consommation moyenne d’alcool par habitant place la France entre le 6ème et le 11ème rang mondial selon les études. Il convient donc d’éduquer les consommateurs de vins. Mais ce n’est certainement pas la Grande Distribution qui va s’en charger, la vente par des réseaux spécialisés, comme la réglementation des débit de boissons, paraît faire partie des solutions envisageables. Existe-t-il un Paradoxe Français ?Le terme "paradoxe français" ou "french paradox" a été inventé pour exprimer le fait que la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires était en France inférieure à celles des autres pays, alors que le niveau des facteurs de risque cardiovasculaire sont similaires. Il est vrai que le taux de mortalité cardiovasculaire est faible en France mais l’interprétation de cette constatation fait l’objet de nombreuses interrogations. Deux courants s’affrontent, celui qui réunit celles et ceux qui pensent que les données actuelles réfutent l’existence d’un "french paradox" à celui des défenseurs de la possibilité d’un "paradoxe français" qui doit motiver des recherches approfondies. Il faut dire que la présence des polyphénols contenus dans le vin rouge est régulièrement mise en avant pour justifier qu’à dose raisonnable (un ou deux verres par jour) ce breuvage aiderait à prévenir le développement des maladies cardiovasculaires grâce à l’action (en particulier) du resvératrol. Pour autant, la modération reste de mise. |
La reproduction totale ou partielle sans permission est interdite.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.